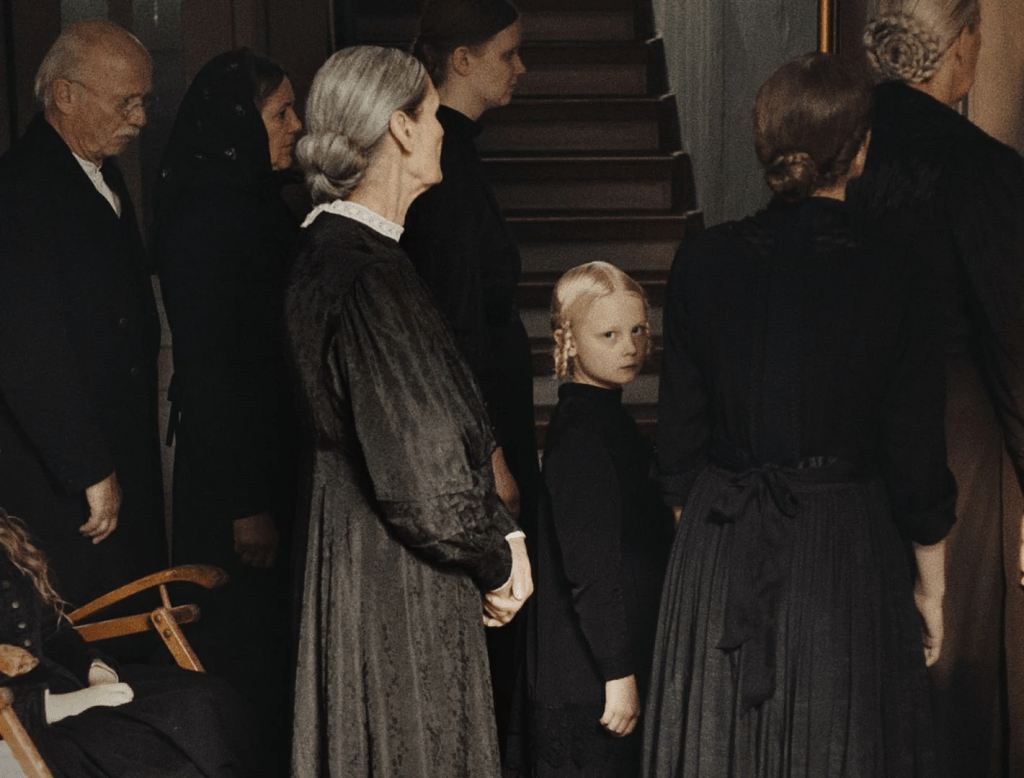C’est accompagné d’une rétrospective intégrale au Centre Pompidou (provisoirement logé dans les salles du MK2 Bibliothèque) que le cinéaste espagnol Jonás Trueba nous donne des nouvelles de 2016. Dix ans nous séparent de la fabrication de La Reconquista, quatrième long-métrage de son auteur et première collaboration avec l’actrice et cinéaste Itsaso Arana. Presque autant de temps qui séparent Manuela et Olmo, jeunes trentenaires et anciens premier amour, qui se retrouvent à Madrid l’espace d’une soirée pour se rappeler leur passé.
Continuer à lire … « La reconquista »