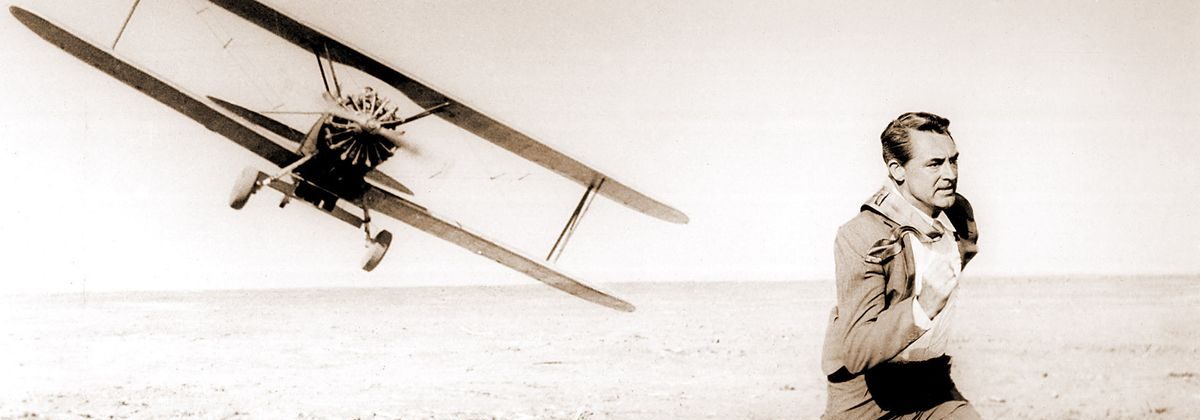Sauve qui peut : Ruben Östlund n’épargne personne. Après avoir exposé les dysfonctionnements dans les dynamiques entre voisins, entre amis, entre familles, entre artistes, c’est au tour des riches. De façon assez amusante cette évolution dans le choix de sujet parle sans doute de celle de la condition du réalisateur : un cinéaste d’un petit quartier en Suède propulsé sur la scène médiatique mondiale après avoir reçu pas une, mais deux Palmes d’or.
Continuer à lire … « Sans Filtre »