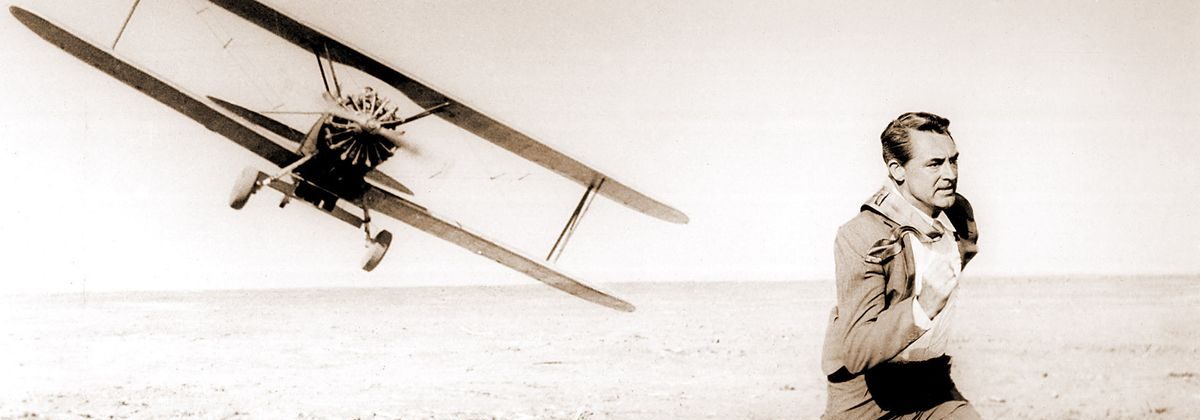« On n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans », disait Rimbaud. Le premier film de Michaël Dichter témoigne que l’on est sérieux avant. À treize ans, entre autres, quand on s’appelle Max, Vivian ou Tom, que l’on est en quatrième, et que l’on souhaite partir coûte que coûte en colonie de vacances, durant l’été, quitte à entreprendre un petit trafic de brownies illégal. En soi, ce n’est pas bien grave, ce ne sont que des mensonges enfantins.
Les trois compères, unis aussi puissamment que par les liens du sang, font les quatre cents coups dans une atmosphère baignée d’une lumière évanescente, presque blanche, qui auréole et idéalise l’idylle d’insouciance dans laquelle ils vivent, soudés comme les doigts d’une main. Les plans sont vastes, volatiles, embrassent leurs mouvements amples, les courses de vélo effrénées dans les bois. Ils sont libres comme l’air. Mais un jour, le frère de Max, Seb, rentre à la maison familiale, et avec lui, arrivent le début des ennuis, et la teinte sociale du film : Seb sort de prison, a un bracelet électronique autour du pied. Il est fébrile, dit avoir remonté la pente, quand il tangue en réalité sur le fil des voyous qui s’encanaillent toujours plus. Le personnage de la mère, distante, déprimée, qui peine à sortir de son lit, si ce n’est contrainte par Max, teinte encore l’intrigue d’un caractère à connotation sociétale, porté par une Emmanuelle Bercot saisissante de lassitude et de morosité. C’est une figure maternelle à l’ouest, dépassée par les problèmes de son fils aîné. Elle semble depuis longtemps avoir abandonné la bataille, enfermée dans une boucle fataliste et presque tragique – tragédie vers laquelle tend irrémédiablement le film, malgré l’aspect solaire des premières images, qui ne viennent cependant que contrebalancer plus profondément la noirceur des évènements à venir, amorcés par la présence de Seb.
Une fois rentré, Seb charge Max d’aller récupérer un sac déposé dans une vieille gare désaffectée. L’atmosphère comme perçue à travers les yeux du garçon, est exacerbée par cette période charnière entre l’enfance où l’on croit encore aux fantômes, et l’adolescence où l’on ferait tout par amour, puis vire à l’horreur : jeux avec les ombres, le surcadrage, dans un esprit presque voyeur pour surprendre le personnage et le spectateur. C’est le signe d’un basculement, le passage dans un autre monde : celui des problèmes d’adultes, du trafic de drogue dans lequel baigne Seb et que Max n’aurait jamais dû connaître. Dans un acte de désespoir face au comportement de Seb, Max balance le sac rempli de substances illicites dans un fleuve : il vient sans le savoir de précipiter son frère dans la haine des règlements de compte, avec ceci de déchirant qu’il voulait le protéger.
Se met en place une rapide descente aux enfers, remplie de paradoxes narratifs forts : en tant que cadet, Max porte sur ses épaules de collégien le poids de l’aîné de la fratrie, qui est pour lui la valeur sacrée par excellence, au même titre que l’amitié. Il est fiable, et cette même fiabilité le pousse à rompre et trahir le lien qui l’unit au clan qu’il forme avec Tom et Vivian, les dénommés Trois fantastiques. Max est construit autour de dilemmes, qui le conduisent à agir contre ses valeurs, et à faire des choix cornéliens.
L’histoire se clôt sur une apogée émotionnelle en reprenant l’image connue du fusil de Tchekhov (lorsqu’une arme est visible à l’écran, d’une quelconque manière, elle sera utilisée a posteriori) : on voit un revolver (un jouet) dont Max se sert pour s’amuser avec ses deux compères. Le pistolet est ensuite réinvesti dans une scène de laser game, qui rend la présence de l’objet plus concrète, par la mise en situation qu’implique le jeu ; il est présenté une troisième fois dans une séquence de vengeance concrète qui place en son centre le harcèlement scolaire. La connotation subtile attribuée à l’objet embrasse le procédé de gradation de l’intrigue qui aboutit, tout en crescendo, à un paroxysme, proposant par là une lecture du film comme une chanson triste : l’arme devient, au fur et à mesure de son utilisation, sérieuse, et traduit le basculement du temps de la candeur vers l’âpre réalité des adultes, contradictoire, faite de choix difficiles qui atteignent les enfants. A leur tour, et par effet de ricochets, ils doivent agir de manière bien plus grave que ce à quoi leur statut les disposait au départ.
De Michaël Dichter / Avec Diego Murgia, Emmanuelle Bercot, Raphaël Quenard / France / 1h35 / Sortie le 15 mai 2024.