
Sur le tournage de son documentaire précédent, M, Yolande Zauberman capte par hasard – presque par accident – deux jeunes femmes dans une rue. Son compagnon lui apprend que l’une d’entre elles est venue à pied de Gaza jusqu’à Tel Aviv, pour pouvoir vivre sa transexualité. Le film part d’une rumeur, d’une histoire qui porte en elle quelque chose de mystique: les protagonistes (des femmes trans) sont auréolées d’une lumière évanescente, pleine de strass, pareilles à des déesses. La cinéaste s’accroche à cette légende urbaine pour retrouver celle qu’elle nomme désormais la Belle de Gaza.
L’esthétique du film s’inscrit dans ce que la réalisatrice nomme « la trilogie de la nuit ». C’est un jeu d’ombres et de teintes ocres, rappelant la photographie de Nan Goldin. On retrouve des thèmes communs aux deux artistes : outre les couleurs étincelantes de la colorimétrie, on décèle un univers nocturne similaire, la question de la sexualité, d’un monde de failles en marge de la société (prostitution, drogues…), une tension entre l’infiniment intime (une orientation sexuelle et une assignation à un genre) et le politique (ce que la société, le pouvoir en place, la religion, mettent en place pour faire face à ces cas que tous jugent anormaux, seulement parce qu’ils constituent une minorité, et représentent un imaginaire qui leur est étranger). La force de La belle de Gaza se situe dans cette tension et cette articulation, palpables dans chaque témoignage, qui libèrent une parole portant en elle le joug du jugement, de la discrimination, du harcèlement.
L’enquête qui marque le point de départ du documentaire n’aboutit pas. « Elle n’existe pas, celle que tu cherches ». Là n’est finalement pas le point d’intérêt : ce dernier réside dans les échanges avec Talleen, Nathalie, Danielle, Nadine, autant de Belles de Gaza, qui acceptent de livrer un pan de leur parcours. Le montage fait se répondre les unes et les autres, de manière floue, sans réel lien si ce n’est une quête identitaire commune. Pour les trois dernières, la vie dans la rue relève presque d’une fatalité : elles possèdent un passé douloureux, marqué par le rejet familial, l’incompréhension, le diktat de la religion. Nathalie se tourne vers l’islam suite à son opération. Durant les entretiens, elle revêt un voile noir pailleté. Saisie d’une telle façon par Yolande Zauberman, elle semble à la fois une Vierge, et une musulmane. Elle porte en elle l’universalité, un sens équivoque qui la place dans un entre-deux. Cela fait écho à ce que souligne Danielle, elle ne souhaite pas se voir désignée par un genre défini : elle assume son statut à la fois masculin et féminin. Elle se maquille, mais si des hommes viennent l’embêter dans la rue, elle leur prouvera, qui d’elle ou d’eux, est véritablement viril : elle a des « couilles », aussi. C’est une figure hermaphrodite que tend à représenter la mise en scène par ses mouvements amples, ses tremblements et sursauts. Elle donne à voir une forme de chaos, qui vient souligner l’effacement des frontières définies, celles qui attribuent une identité normées, qui rentre dans une case. Les jeunes femmes quant à elles, sont d’origine diverses, possèdent des croyances qui leur sont propres, un avis sur la transidentité différent.
Elles sont magnifiquement hors-normes, en dehors des attendus. Elles brouillent les lignes de force pour en dessiner d’autres, courbées, qui n’obéissent à rien d’autre qu’à une volonté de s’affirmer, de se trouver, de s’accepter comme elles sont ; c’est à dire à la limite de… sur les bords, en dehors. Ce sont les prémisses d’une révolution.
La Belle de Gaza / De Yolande Zauberman / France / 1h16 / Sortie le 29 mai 2024.
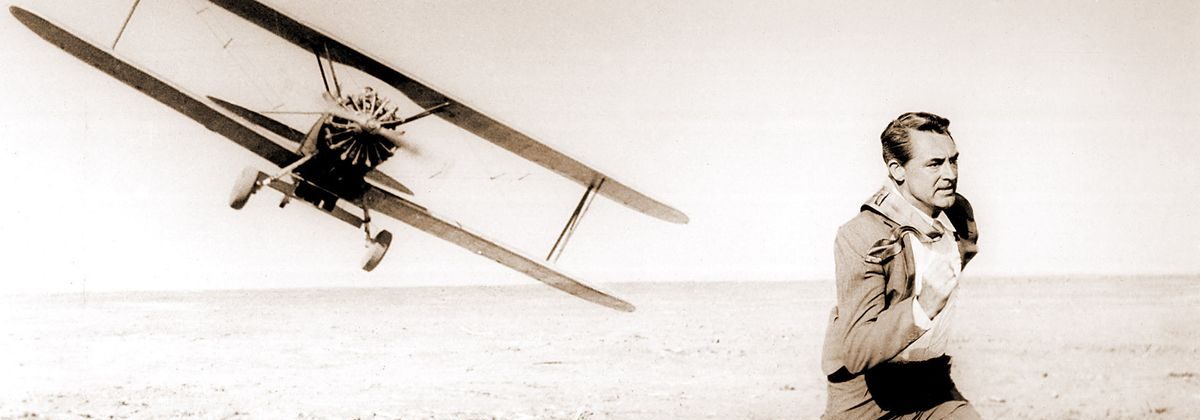
Belle chronique qui donne envie! Je note !
J’aimeJ’aime